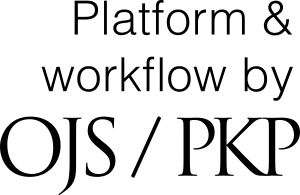L’ENJEU ALIMENTAIRE DANS L’ACCORD UE-MERCOSUL: UN POINT DE VUE EUROPÉEN
DOI:
https://doi.org/10.9771/rppgd.v35i0.66438Palavras-chave:
alimentaire, Commerce, MercosulResumo
Après l’accord de principe du 28 juin 2019, la Commission européenne a publié, de façon numériquement plus accessible, « compte tenu de l’intérêt croissant du public pour les négociations », comme elle le reconnaît elle-même, les différents éléments de la partie commerciale du futur accord.[1] Les simples fiches d’information ne permettent pas de faire une analyse critique, puisqu’elles sont très synthétiques et tournées vers la justification des termes de l’accord. Parmi les différents éléments, destinés à devenir les chapitres du futur accord, plusieurs permettent d’apprécier l’enjeu alimentaire mais encore faut-il les rapprocher et les croiser, pas moins de sept chapitres : Commerce des marchandises et son annexe X Commerce des vins et spiritueux, Douanes et facilitation des échanges, Mesures SPS, Dialogues, Propriété intellectuelle et ses annexes, Commerce et développement durable, Règlement des différends.
Ce secteur a toujours été la pomme de discorde entre les deux marchés. Secteur de spécialisation et d’exportation côté Mercosul, secteur protégé côté Union européenne/UE. L’accord de l’OMC sur l’agriculture en 1995 a cependant contraint l’UE à faire céder ses barrières tarifaires, mais celle-ci n’a pas abandonné ses producteurs ni bradé son patrimoine alimentaire.
En réalité, si l’on regarde les différends commerciaux à l’OMC, on peut dire qu’il n’existe pas de guerre commerciale entre les deux. Peu de différends (surtout sur les subventions européennes), la moitié d’entre eux se réglant au stade des consultations ; ils concernent toutefois des produits emblématiques : poulet et café brésiliens, vins et OGM argentins.[2]
En effet, les principales exportations du Mercosul vers l'UE sont des produits agricoles ou alimentaires, quand les exportations de l'UE vers le Mercosur sont principalement des machines et des produits chimiques et pharmaceutiques. Les produits agricoles et agro-alimentaires ne représentent que 5% des exportations européennes vers le Mercosur.[3] La formule « cows versus cars » résume de façon caricaturale l’enjeu de l’accord. Si l’on considère l’enjeu alimentaire, on est tenté par la formule « viande contre produits laitiers ».
Or, cows et cars sont aussi deux sources comparées du changement climatique, qui conduisent à mettre en perspective le libre-échange avec d’autres enjeux, de même que la viande et le lait, échangés sur de si longues distances à partir d’espaces juridiques différents, nous questionnent sur les caractéristiques de ce que nous mangeons. La dimension quantitative du commerce se double d’une dimension qualitative incarnée par les normes, notamment les normes sanitaires et phytosanitaires, qui ne sont qu’un noyau à l’intérieur de toutes les normes susceptibles d’interférer avec l’échange commercial (normes environnementales, normes sociales, normes patrimoniales…). Le concept de norme ne doit pas faire illusion ; les normes ne constituent pas un ensemble homogène et cohérent, loin de là. Quand la Commission assure, dans son accord de principe, que les normes SPS sont non négociables, l’enjeu devient alors celui de la bonne connaissance de la définition de ces normes par rapport à toutes les autres !
L’enjeu se glisse dans les délimitations de ce qui est non négociable par rapport à ce qui est négociable. L’enjeu alimentaire devient un enjeu normatif, qui fait écho à la stratégie de l’UE pour devenir un leader mondial par sa capacité à imposer les normes de la transition vers des systèmes alimentaires durables[4].
L’accord UE-Mercosul répond-il à cette ambition ? Les deux parties ont négocié des normes qui introduisent dans le libre-échange, valeur partagée, une préoccupation patrimoniale dans le domaine de l’alimentation, identité et qualité en étant les deux critères juridiques structurants[5]. Ainsi, le libre-échange parvient à intégrer la notion de patrimoine alimentaire selon l’origine des produits et la recherche de la qualité de l’alimentation par le respect des normes sanitaires, environnementales et sociales. Mais l’originalité de l’accord sur le premier point est limitée par toutes sortes de clauses et la portée de l’accord sur le second point est conditionnée par une approche des normes, qui ne peut être que source de quiproquo entre les parties.
Les deux grands compromis, d’une part, entre libre circulation des marchandises et reconnaissance du patrimoine alimentaire selon l’origine, d’autre part, entre sécurité sanitaire (non négociable) et « libre disposition » des ressources environnementales et sociétales mondiales (par des exigences faibles pas encore reliées au commerce), relativisent beaucoup la capacité de l’UE à diffuser ses valeurs par le commerce.
[1] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/mercosur/eu-mercosur-agreement/agreement-principle_en
[2] Voir annexe 1 Etat des différends à l’OMC, Europe, Mercosul, Alimentation
[3]https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/mercosur/ (base de 27 Etats Membres)
[4] Voir la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement, 20 mai 2020, COM/2020/381 final
[5] Hannequart Isabelle (dir.), Les lois de la table, Table des Hommes, PUFR, 2019, p. 23
Downloads
Downloads
Publicado
Como Citar
Edição
Seção
Licença
Copyright (c) 2025 Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
1. Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional que permite o compartilhamentodo trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.
2. Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.
3. Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho publicado